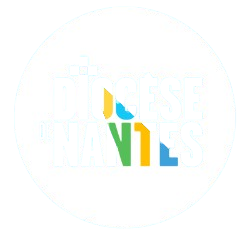En lien avec l’exposition « En guerres, 1914-1918 / 1939-1945, Nantes / Saint-Nazaire » du Musée d’histoire de Nantes, les Archives diocésaines vous invitent à feuilleter quelques pages évocatrices des deux conflits mondiaux dans le diocèse de Nantes.

Première Guerre Mondiale
L’affiche du Père Doncoeur de la Ligue Des Droits Du Religieux Ancien Combattant (1924)
 Cette affiche est plus que le coup de sang d’un homme. Elle affirme avec véhémence les revendications des religieux revenus de leur exil forcé pour combattre dans les rangs français.
Cette affiche est plus que le coup de sang d’un homme. Elle affirme avec véhémence les revendications des religieux revenus de leur exil forcé pour combattre dans les rangs français.
Dès le 2 août 1914 les lois anti-congréganistes de 1901 et 1904 sont suspendues par une circulaire du ministre de l’Intérieur. Ce sont 9323 religieux qui répondront à la mobilisation ; 1237 d’entre eux seront blessés et 1571 perdront la vie dans les combats.
Moins de six ans après la fin de la guerre, Edouard Herriot, président du conseil, annonce le 2 juin 1924 l’expulsion des congréganistes, la suppression de l’ambassade auprès du Saint-Siège et l’application de la Loi de Séparation des Eglises et de l’Etat à l’Alsace et à la Moselle. Deux mois plus tard, Dom Moreau, bénédictin de l’abbaye de Ligugé, ancien aumônier militaire, blessé et gazé, lance la Ligue des Droits du Religieux Ancien Combattant (Ligue DRAC). En octobre Paul Doncoeur, jésuite, publie une lettre ouverte à M. Herriot. Elle sonne comme le manifeste de ce mouvement naissant et se diffuse par tracts et par affiches.

Concrètement, beaucoup de religieux rejoignent l’association et aucun ne quittera le territoire. On peut ainsi voir défiler à Nantes, lors de la Journée des anciens combattants du 11 novembre 1934, une partie de la délégation de la Ligue des Droits des Religieux Anciens Combattants devant les Tables Mémoriales, avec notamment les Capucins nantais et les pères jésuites de l’Institut catholique professionnel de la Joliverie.
Ce n’est qu’en septembre 1940 que l’Etat français lèvera l’interdiction frappant les congrégations religieuses par une loi reprenant un projet préparé à la fin de la IIIe République. Cette loi sera entérinée à la Libération. La Ligue DRAC vivra jusqu’en 1993 sous son appellation d’origine pour devenir à cette date « Défense et Renouveau de l’Action Civique ».

Les Archives Historiques du diocèse de Nantes (AHDN) conservent les archives permettant de retracer l’engagement des prêtres et séminaristes du diocèse de Nantes dans l’armée française, ainsi que quelques pièces relatives à l’association des prêtres anciens combattants et à la Ligue des Droits des Religieux Anciens Combattants (DRAC).
Les archives de la DRAC sont conservées à Paris (8 bis rue Vavin, Paris VIe). La série F, qui présente les différentes activités, se révèle comme le plus riche du fonds : actions juridiques et politiques, manifestations publiques, conférences, coupes d’éloquence des lycéens, production de films, publications, relations avec les autres associations d’anciens combattants… Nous avons là les traces d’une fraction significative de la population française qui témoigne des suites de « l’Union sacrée » entre les deux guerres voire au-delà.
Déjà 20 mois de guerre. L’Eglise nantaise n’a pas rechigné à se joindre à l’effort de la Nation. Toutes les paroisses sont touchées et mobilisées pour répondre aux multiples besoins engendrés par le conflit.

Dans un communiqué paru dans la Semaine religieuse le 11 mars 1916, l’autorité diocésaine lance une sorte d’enquête auprès des paroisses, afin de
savoir ce qui se pratique concrètement en chacune d’elle, au titre de ce qu’il est convenu d’appeler les « œuvres de guerre ». La chose semble urgente, les paroisses sont priées d’adresser la réponse sous huit jours. La motivation reste vague, le communiqué indique seulement : « il est utile et même nécessaire d’avoir, dès maintenant, une vue d’ensemble sur les œuvres catholiques accomplies durant la guerre dans le diocèse. »
Pour ce faire, le communiqué prend soin de fournir sinon une grille, du moins une liste d’œuvres bien connues, sous laquelle se perçoivent deux volets distincts : un premier concernant les pratiques religieuses (prières, offices, dévotions) spécialement proposées à l’intention de la France et de ses soldats, un second visant les entreprises menées pour le soutien matériel et humain des populations et des soldats.
Aucune synthèse ou exploitation de cette « enquête » ne figure dans les archives de l’évêché.
Les réponses
 Les réponses de 96 paroisses y sont par contre conservées dans les archives du secrétariat de l’Evêché (cote 3D17), sans que l’on sache si les autres paroisses (le diocèse compte à cette date 57 cures et 204 succursales) ont répondu. Cet échantillon – qui émane de l’ensemble du territoire – sans être strictement représentatif semble toutefois un bon indicateur des tendances générales, tout en faisant place à certaines originalités.
Les réponses de 96 paroisses y sont par contre conservées dans les archives du secrétariat de l’Evêché (cote 3D17), sans que l’on sache si les autres paroisses (le diocèse compte à cette date 57 cures et 204 succursales) ont répondu. Cet échantillon – qui émane de l’ensemble du territoire – sans être strictement représentatif semble toutefois un bon indicateur des tendances générales, tout en faisant place à certaines originalités.
Les lettres, datées de mars ou du début d’avril, s’appuient sur le questionnaire proposé. Le curé en est toujours le signataire. Il y joint parfois une note du directeur de l’école ou plus fréquemment de l’institutrice. Sa réponse peut être brève, une simple page, ou se développer sur 5 à 6 pages.
Télécharger la liste des paroisses contributives à l’enquête.
Les acteurs cités
Au rang des acteurs de toutes ces « œuvres de guerre », le curé fait bonne figure. Il est l’ordonnateur plutôt zélé des offices religieux ordinaires ou extraordinaires, et le support, voire parfois l’animateur de certaines œuvres profanes. Il lui arrive de s’associer avec le maire de la commune pour certaines réalisations et la mobilisation de bonnes volontés locales. Les vicaires n’apparaissent quasiment pas car beaucoup sont sous les drapeaux, de même que les instituteurs.
Les femmes tiennent un rôle moteur sur différents chantiers. Bien sûr elles fréquentent en masse les offices religieux proposés et animent par elles-mêmes des rencontres de dévotion. Dans la quasi-unanimité des paroisses, elles assument nombre de tâches pratiques : collecte et confection de vêtements et colis pour les soldats, fournitures (linges et subsistances) pour les ambulances locales ou voisines, accueil et équipement des réfugiés, soutiens aux familles déstructurées par le conflit, quêtes en argent ou en nature, etc. Les Ligues féminines catholiques (Ligue patriotique des Françaises et la Ligue des Femmes françaises) sont au premier rang de l’action, à côté de dames de l’aristocratie et de religieuses dévouées aux hôpitaux et ambulances. Les institutrices libres et leurs élèves sont généralement présentes aux exercices religieux mais tout autant aux travaux de tricot ou au traitement des étoffes et des linges destinés aux combattants comme aux blessés ou aux prisonniers.
Entrainée par ces bonnes volontés, la population se donne à fond, surtout les premiers mois du conflit. Sous la plume du curé, elle apparait sous deux vocables, les « paroissiens » ou les « habitants », sans que l’ambigüité soit toujours levée sur l’étendue de chaque dénomination.
Pour aller plus loin :
- Voir l’Exposition virtuelle 14-18 : A l’arrière – Des œuvres paroissiales à l’Association diocésaine d’assistance aux victimes de la guerre.
- Article de Monsieur l’abbé Jean Bouteiller sur « L’engagement des paroisses dans les « œuvres de guerre » – Présentation de l’enquête diocèse de 1916 » (à paraître en 2016).
Deuxième Guerre Mondiale
« Depuis le début de cette semaine, il n’y a plus guerre d’illusions à avoir. La Seine est franchie par les Allemands ; Paris est occupé. Il faut se préparer à toute éventualité à Nantes même… »
(Mgr Villepelet, Carnets de guerre, 14 juin 1940).

Les Archives diocésaines ont la chance de pouvoir disposer des carnets personnels de Mgr Jean-Joseph Villepelet, évêque de Nantes (1936-1966). Ceux-ci, rédigés du 14 juin 1940 au 7 mai 1945, couvrent les principaux événements dont le prélat a été le témoin ou l’acteur comme chef du diocèse. Ils éclairent non seulement sa personnalité et sa conception de ses relations avec les autorités civiles et l’armée d’occupation, mais également, et d’une façon plus générale, les années tragiques vécues par les populations du département. Ce témoignage éclaire l’histoire locale mais aussi l’histoire de l’Eglise de France durant la guerre.
Les carnets ont fait l’objet, en 2007, d’une édition commentée par Marcel Launay, professeur émérite de l’Université de Nantes, spécialiste de l’histoire du catholicisme à l’époque contemporaine.
Pour en savoir +
Au-delà de ces carnets, les Archives diocésaines conservent les fonds d’archives de Mgr Villepelet, de ses vicaires généraux, tel l’abbé Guiho, et du secrétariat de l’évêché, qui permettent, entre autres, de suivre le clergé diocésain pendant la Deuxième Guerre mondiale : mobilisation, prisonniers de guerre, décès, heurts avec les forces d’occupation…
« […] A mon avis l’écueil principal du camp de concentration : un matérialisme bas et épais, une atmosphère de bête traquée, un abrutissement qui vous gagne, la fatigue aidant, et vous réduit à l’état d’automate en vous dépouillant de toutes les valeurs humaines qui sont les raisons de vivre. […] ».
Pierre Moreau
Pierre MOREAU
 Originaire de Nantes,
Originaire de Nantes,
Pierre Moreau est ordonné prêtre en 1935. Il entre dans la compagnie de Saint-Sulpice et enseigne au Grand Séminaire de Bourges. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en juin 1940, réussit à s’évader et revient à Bourges. Le jeune prêtre reprend son activité professorale et clandestinement aide de nombreuses personnes à traverser la ligne de démarcation. Il est arrêté par la Gestapo le 25 juin et condamné à mort le 12 décembre 1942 pour complicité d’une organisation de résistance. Il est finalement transféré en Allemagne, d’abord dans une maison de réclusion sinistre, puis au camp de concentration d’Oranienburg-Sachsenhausen en novembre 1944. Survivant à la « Marche de la Mort », il est libéré en mai 1945.
 Ayant intégré la Mission de France en 1955, il part en Algérie et est confronté à nouveau aux violences et actes barbares. Ayant des amis musulmans, il est mal vu par l’OAS qui le prend pour cible, allant jusqu’à faire exploser sa voiture dans la cour du presbytère. Pierre Moreau est décédé en 1993 à l’âge de 83 ans et nous a laissé un témoignage simple et bouleversant sur son « boulot de prêtre ».
Ayant intégré la Mission de France en 1955, il part en Algérie et est confronté à nouveau aux violences et actes barbares. Ayant des amis musulmans, il est mal vu par l’OAS qui le prend pour cible, allant jusqu’à faire exploser sa voiture dans la cour du presbytère. Pierre Moreau est décédé en 1993 à l’âge de 83 ans et nous a laissé un témoignage simple et bouleversant sur son « boulot de prêtre ».
Henri PLOQUIN
Originaire de Rezé, Henri Ploquin est vicaire à Bouvron lorsque survient la guerre. Il rejoint la Résistance à la mi-décembre 1943 et commence à regrouper autour de lui les jeunes de sa paroisse touchés par les réquisitions pour le STO en Allemagne. Avec le débarquement en Normandie, l’espoir se concrétise dans le maquis où on attend un parachutage d’armes et de munitions. A la mi-juin, près de 200 combattants rejoindront la forêt de Saffré, dont le groupe de Bouvron de l’abbé Ploquin.Le 28 juin 1944, de violents combats opposent les maquisards et les forces occupantes. Certains sont tués, d’autres sont arrêtés et condamnés par un tribunal militaire le lendemain. 27 seront fusillés immédiatement, les autres seront assassinés dans la prison de Nantes ou déportés en camps de concentration. Parmi ces derniers, se trouve l’abbé Henri Ploquin. Après un passage dans plusieurs prisons, il échoue au camp de Brandebourg-Görden. Il est libéré le 27 avril 1945 par les troupes soviétiques. Henri Ploquin a rédigé ses souvenirs dans un manuscrit publié par l’Association des Amis de Rezé en 2007.


Joseph HERVOUËT
 Originaire de Saint-Lumine-de-Clisson, Joseph Hervouët est vicaire à Saint-Julien-de-Vouvantes en 1944. Arrêté le 21 janvier 1944 par la Gestapo pour faits de résistance, il est déporté en Allemagne dans les camps de Mathausen et de Dachau. Il sera libéré le 29 avril 1945. A la demande de ses paroissiens de Montoir, il a écrit ses « Souvenirs de déportation – Mathausen – Dachau », dont la première publication a lieu dans le bulletin paroissial de Montoir en 1951.
Originaire de Saint-Lumine-de-Clisson, Joseph Hervouët est vicaire à Saint-Julien-de-Vouvantes en 1944. Arrêté le 21 janvier 1944 par la Gestapo pour faits de résistance, il est déporté en Allemagne dans les camps de Mathausen et de Dachau. Il sera libéré le 29 avril 1945. A la demande de ses paroissiens de Montoir, il a écrit ses « Souvenirs de déportation – Mathausen – Dachau », dont la première publication a lieu dans le bulletin paroissial de Montoir en 1951.
Michel BROUARD
L’abbé Michel Brouard (1919-1944), originaire de Nantes, est un tout jeune prêtre ordonné en 1943 et professeur d’allemand à l’Institut Saint-Joseph d’Ancenis en 1944. Il fait partie d’un groupe pris par les Allemands alors qu’ils se préparaient à traverser la Loire en bateau, ce qui était strictement défendu, les Américains occupant l’autre rive. Ils sont fusillés secrètement le 13 août 1944. Leurs corps sont découverts 25 jours plus tard dans un charnier au Pré Rouge, sur la commune du Landreau. L’abbé François Vicet a réalisé un dossier intitulé « Les chemins de l’horreur, août 1944 – Ancenis, Drain, Liré, Le Loroux-Bottereau, Le Landreau » sur le drame en rassemblant des informations sur le contexte, des témoignages et de la documentation sur les personnes impliquées. Cet opuscucule a été édité à compte d’auteur en 1995-1996
Destruction de clochers sur la ligne de front : Guenrouët, Bouvron, Notre-Dame-de-Grâce…
 En octobre 1946, est constitué le Groupement des édifices religieux sinistrés de la Loire-Inférieure (devenu ensuite la Coopérative de Reconstruction des Eglises et Edifices Religieux Sinistrés de la Loire-Inférieure). Elle prend acte des destructions dues à la guerre et amorce la reconstruction.
En octobre 1946, est constitué le Groupement des édifices religieux sinistrés de la Loire-Inférieure (devenu ensuite la Coopérative de Reconstruction des Eglises et Edifices Religieux Sinistrés de la Loire-Inférieure). Elle prend acte des destructions dues à la guerre et amorce la reconstruction.
Considérant que les propriétaires et les usagers des églises dévastées doivent concourir à la reconstruction, un groupement à l’échelle diocésaine est créé pour unir les efforts des intéressés. Cette organisation a fait ses preuves, car on lui doit la reconstruction des églises dévastées pendant la première guerre mondiale. En pratique, la Coopérative renseigne et agit auprès des organismes administratifs pour le compte de ses membres. Elle permet la centralisation des efforts de tous, notamment sur le plan financier. Elle constitue une centrale d’achat fournissant les matériaux, recueillant les emprunts nécessaires auprès des catholiques, afin de constituer les avances indispensables pour le financement de la reconstruction.
Les archives de cet organisme regroupent, outre les pièces d’administration de la société, les nombreux dossiers de travaux (plans, devis, factures, photographies de chantier) concernant les églises, presbytères, écoles, patronages, évêché, couvents… des paroisses de la Poche de Saint-Nazaire et de Nantes (dont le Temple protestant) dans une soixantaine de paroisses.


« Notre Dame de Boulogne, ramenez mon fils prisonnier. Préservez-nous des bombardements et faîtes cesser la guerre. »
(Billet d’ex-voto jeté dans la barque, été 1944).

Manifestation autant patriotique que religieuse, le Grand retour de Notre Dame de Boulogne en Loire-Atlantique se déroule pendant la Libération (juin-juillet 1944). Au passage de la vierge, une grande procession se forme; des prières, des ex-votos sous forme de billets ou de photographies sont déposés dans la barque de Notre Dame.
Du 28 mars 1943 au 29 août 1948, les quatre reproductions de la statue de Notre-Dame de Boulogne sillonnent la France, entraînant des foules à pied qui, en priant et en chantant, accompagnent la Madone. Dès le départ de Lourdes en 1943, le but affiché est la consécration au Cœur Immaculée de Marie du plus grand nombre de Français et la conversion des pêcheurs. Mais dans ce climat de guerre, les missionnaires font prier pour le retour des absents (prisonniers, déportés, requis du STO, déplacés), pour la préservation des bombardements et pour le « Salut » de la France.

La Semaine religieuse du diocèse de Nantes publie les relations du « chroniqueur » du Grand Retour qui se déroule dans le diocèse de Nantes (Loire-Inférieure) en juin et juillet 1944. Pour recevoir le Grand Retour, on organise des cortèges, on décore le chemin que doit emprunter la statue avec des arcs de triomphes, des guirlandes.

A la musique qui accueille également la statue (cantiques, cloches de l’église, fanfare), s’ajoutent les acclamations et les cris de « Sauvez la France » et Ramenez nos prisonniers ».

La population peut toucher la statue, baiser son manteau. Les participants sont invités à déposer leur feuillet de consécration dans la barque où l’on jette aussi des billets portant des intentions, des images, des photos des absents, des offrandes, des chapelets. A Couëron, un cœur est déposé devant la barque, symbolisant les 600 absents de la paroisse. Portés par une grande ferveur religieuse, certains accompagnent la Madone pieds nus !




L’évolution des événements miliaires perturbe le déplacement de la statue dans le diocèse : la ville de Nantes doit renoncer à ses projets d’accueil triomphal et la statue se contente d’une réception dans la petite paroisse de Notre-Dame de Lourdes (25 juin 1944). A la fin du mois de juillet, la statue se trouve prise dans la poche de Saint-Nazaire, qu’elle quittera en traversant clandestinement la Vilaine au sud de Redon.
A la lecture de ces archives, s’il vous revient en mémoire l’existence d’archives, de témoignages écrits ou photographiques, que vous souhaiteriez partager, nous serions intéressés à en prendre connaissance.
Contacter les Archives historiques (archivesdiocesaines@ad-nantes.org)